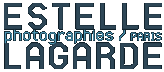L'Auberge
Marie Deparis-Yafil, commissaire d’exposition et critique d’art membre de l’AICA. 2015.
Pour la première fois sans doute, Estelle Lagarde a ici opté pour une certaine fraîcheur, une légèreté qui lui sont inhabituelles. Et les textes qui accompagnent les images, bien que laissant toute possibilité narrative ou fictionnelle aux photographies, ouvrent à une poésie gouailleuse et décalée et nourrissent la fantaisie de ce projet photographique, dont l'humour flirte parfois avec l'absurde. Cette liberté de ton délestée semble nouvelle pour Estelle Lagarde dont on a connu des travaux plus sombres et plus inquiets. Il ne s'agit pas pour autant d'une simple variation, ou d'un revers, d'un retournement ; on y retrouve assurément son vocabulaire formel, une filiation avérée avec ses séries précédentes, et une réflexion, plus subtile encore, sur la question essentielle de la temporalité.
Parmi les éléments récurrents dans son œuvre : le choix d'un lieu à l'abandon – ici cet hôtel-restaurant resté « dans son jus », avec ses papiers peints et ses nappes à fleurs –, une dramaturgie précise des images habitées par d'étranges et fantomatiques présences-absences, comme des songes ou des ombres, des traces, des souffles… Car il y a toujours chez Estelle Lagarde, même sous les dehors les plus légers, comme ici, quelque chose de fragile et d'intranquille, et les images de L'Auberge ne dérogent pas à cette nécessité intérieure, fil conducteur de toute son œuvre, cette conscience aiguë du temps qui passe et de la disparition.
Oui, la mort rôde toujours, celle de ceux qui un jour passèrent par là, y burent, mangèrent et dormirent, aimèrent maris, femmes et enfants… Que sont-ils devenus ? On entendrait presque, comme un écho lointain, aussi attendrissants que mélancoliques, l'orchestre d'un mariage célébré ici, les cris et les rires, tous évanouis dans les limbes de l'irréversible et des étés perdus. On se prend à se remémorer au fil des images « les rencontres sans lendemain et toutes les premières-dernières fois perdues dont notre route est semée*. » Car qu'est-ce que la nostalgie sinon la conscience de quelque chose d'autre, d'un ailleurs, d'un contraste entre passé et présent ? Et cette nostalgie n'est-elle pas provoquée essentiellement par l'irréversibilité du temps, le flux insaisissable de la temporalité ? « Un voyageur peut toujours revenir sur ses pas. Mais sur l'axe du temps, il n'y a pas de retour en arrière. Ce qui est perdu l'est à tout jamais**. » L'objet de la nostalgie, ce n'est pas tel ou tel passé, mais le fait même du passé, « dont la relation avec la conscience d'aujourd'hui, justifie que le charme inexprimable des choses révolues ait un sens*** ».
Pourtant, à l'instar de l'Ulysse déçu de son retour à Ithaque, décrit par Jankélévitch, inutile d'espérer trouver ici la trace d'une véritable et authentique histoire (res)sortie du passé. Le voyage dans le temps est un impossible voyage ; Estelle Lagarde l'a compris, contournant l'écueil de la reconstitution, de l'évocation passéiste. Ses mises en scène offrent sans détour ce décalage qui dit : « Rien ne pourrait jamais être semblable à ce qui fut, aussi, voici autre chose, une autre histoire… » Personne, pas même ceux qui y vécurent, ne revient à l'auberge de Saint-Yrieix-le-Déjalat, et ne retrouve ici les images de ce passé. Estelle Lagarde construit bien autre chose, une fantasmagorie de la nostalgie : telle est la force de cette série qui affirme, paradoxalement, que rien n'est déjà là.
Alors Estelle Lagarde peut-elle se saisir pleinement de la liberté de la fable, jouer du fantastique et de l'onirique, écrire un poème ou un conte de fées, parfois réjouissant, parfois angoissant, dans lequel la présence menaçante ou déjà trépassée d'animaux – corbeaux noirs et autres gallinacées – renforce l'affleurement permanent de l'éphémère et de la mort.
Cette allusion à la mort se tient aussi probablement dans la substantielle présence de la nourriture qui ponctue les images ; ainsi de l'impressionnante Vénus barbaque, sorte d'autoportrait vorace et étonnant. C'est que le point de départ du projet de L’Auberge était intimement lié à une réflexion sur la nourriture, au rapport que nous entretenons avec elle. Or quel lieu plus évident qu'une auberge, dont la dimension triviale est le principe même, dès son apparition au Moyen Âge ? Car à l'auberge depuis toujours, on vient pour satisfaire les besoins les plus primaires, manger, boire, dormir… d'où cette espèce de sensualité presque rabelaisienne qui ressort de ce travail, tant par les images – faisant la part belle à cette dimension prosaïque de la nourriture – que par les textes les accompagnant, les jeux de mots et l'utilisation d'expressions populaires prises poétiquement « Tu me saoules » ou encore « Je vais te manger » (La Marmite), prononcé par une mère à son bébé posé sur la table dans une marmite !
Et justement, cette sorte de voracité, ce lien organique au corps et à ce qui le nourrit s'inscrivent tout autant, sinon davantage, comme une apologie de la vie, de ce qui tient en vie mais aussi de ce qui relie. Car la question de la nourriture, au-delà de sa dimension charnelle – et l'auberge là encore, dans son histoire, le confirme – fonctionne à la fois comme lien social (la salle à manger, le bar) et lien familial (le repas de famille), évoquant le couple, l'enfance, la domesticité… rarement exemptée des petites misères de la vie conjugale, comme en attestent par exemple le vieux couple des Botanistes, celui des Improbables, des Tapettes ou encore la pièce montée déjà en péril de La Cerise sur le gâteau.
L'Auberge excite ainsi tout un imaginaire fertile autour de l'hôtel, des histoires qui s'y vivent, des voyageurs qui s'y croisent, entrelaçant leurs destinées, puis disparaissant ; elle incarne le lieu idéal pour matérialiser ce souci de l'histoire et du vécu. Car il y a peu d'endroits aussi chargés que ces chambres où dormirent tant de personnes, lieux de passage, « abris transitoires, théâtres de drames et de joies, espaces anonymes**** », que cette salle à manger dont les murs portent fantasmatiquement l'empreinte invisible des fêtes, mariages et anniversaires qui s'y déroulèrent, que le bar où s'accoudèrent tant de gens venus noyer leurs soucis et leurs chagrins, ou rire, ensemble, à la croisée de l'intime et du collectif… Toutes ces vies mêlées, perdues, effacées, ce concentré du monde, cette comédie humaine oscillant perpétuellement entre l'évidence du drame et l'éphémère plénitude d'un moment de grâce.
__________
* Vladimir Jankélévitch, L'Irréversible et la Nostalgie, éd. Flammarion, 1983.
** Ibid.
*** Ibid.
**** d'après Nathalie H. de Saint Phalle, Hôtels littéraires, éd. Quai Voltaire, 1991.
>>
Retour aux textes