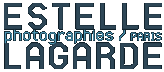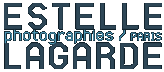
Les Pionniers
Un cancer à la trentaine me donnait peu de chances de vivre. Je craignais de mourir, mais ne pas donner la vie était pire que de la perdre. Dans ce cauchemar, je faisais des rêves : nous avions un enfant et nous nous sauvions tous les trois, vêtus de blanc, sur une autre planète.
Pendant qu'ils me soignaient pour me protéger de moi-même, je faisais le vœu de retourner sur l'île. Allongée sur mon lit, je me souvenais de ce voyage fait quelques années auparavant, des marches sur les plages de sable noir, de la lumière sur la mer, de l'air pur. Je me revoyais arpentant les champs de lave, en me promettant de leur faire découvrir ces admirables paysages.
Voulant me donner la force de me battre, il me disait qu'au pied de la chute, je trouverai un trésor.
Je pensais : Faut-il tomber de si haut pour réaliser ce qu'est la vie ?
Je souhaitais crier mais qui aurait voulu m'entendre ? Il n'y avait personne à la ronde, que l'écho de ma souffrance. Je pensais crier mais j'avais la tête sous l'eau. J'entamais un journal photographique racontant mon désir de vivre et peu à peu, les remèdes me guérissaient. Au début de ma rémission, un an à peine après cette traversée imprévue*, notre fille arriva comme un miracle. Chaque naissance est une promesse faite à l'avenir.
Dix ans plus tard, nous réalisions mon rêve : nous partions en voyage sur l'île. J'étais d'autant plus heureuse de le faire que toute la planète était immobilisée par la pandémie. J'embarquais quatre pellicules couleur passées en péremption qui végétaient dans le bac à légumes, et quatre pellicules noir et blanc. Seulement. Se limiter en bobines était une contrainte qu'avec l'expérience et l'usage de la chambre, j'avais appris à respecter pour ne pas multiplier les points de vue à l'infini. Je comptais sur mes fidèles Nikon et Pentax, les deux boîtiers argentiques qui m'avaient accompagné dans mon premier voyage, vingt ans plus tôt. J'imaginais déjà l'éclaté nébuleux du grain d'un tirage grand format, les discussions sur le rendu avec mon tireur.
Nous nous envolions enfin, libérés de cette quarantaine pour retrouver les grands espaces.
Aussitôt installés dans notre camping-car, je chargeais précautionneusement mes pellicules. Je n'avais qu'une idée pour cette série : celle de me laisser envoûter par les lieux, de marcher à leurs côtés au sein de ce territoire indomptable. Dans l'immensité du silence, je mesurais la fragilité de l'homme. Dans une nature crue et sans égards pour lui, dans ces décors de genèse, ces déluges d'orages, d'éruptions volcaniques, de geysers sulfureux, de débuts du monde, je saisissais la beauté des éléments qui nous avaient faits. L'essentiel m'apparaissait. A chaque cliché, je prenais conscience de notre présence ici, de ce voyage qui, de conte devenait réalité.
Le lendemain, je me baignais nue dans l'eau froide de la cascade. Je me ressourçais dans le mouvement perpétuel de l'eau qui comme le temps, notre allié, rend le monde possible. Je levais la tête pour admirer les deux merveilleux arcs-en-ciel au-dessus de moi, rencontres colorées des larmes et de la joie. La légende disait qu'à leur pied avait été caché une nymphe, un dieu, ou des elfes. J'imaginais que notre fille en faisait partie et qu'elle avait toujours vécue là. Il est des paysages admirables qui vous enseignent le recueillement et la liberté. Leur rudesse monumentale augmente l'humilité tout en vous rendant plus fort. Le bruit assourdissant des chutes d'eau nous rappelait une chose : la nature est grande, et l'humain, tout petit à côté.
En haut de la colline, une petite chapelle piquait la nuit de son clocher. Je ne suis pas croyante, alors je restais à sa porte pour prier. Je ne demandais plus rien, j'avais tout ce que je voulais. Je remerciais. Dans le noir sidéral, à des années lumières, il y avait là-haut des milliards de brillantes étoiles comme autant de vies sur la terre. Je fredonnais une chanson de Billie : aussi longtemps que je suis là, personne ne peut te blesser, en rentrant à la camionnette où ma fille était endormie.
Au bout de notre road-trip, il me restait trois clichés. Je lui passais le boîtier couleur en lui disant : « Vas y mon cœur, à toi de photographier. » Je voulais lui donner le goût de la beauté du monde. Elle s'installait seule face au paysage, réussissait à le faire entrer tout entier dans le cadre, puis elle déclenchait. Quand ce fût fait, je l'entendis m'appeler et me retournais.
En la voyant courir vers moi, je pensais : « la vie est un trésor. »
Christophe Lambert et Estelle Lagarde
*La traversée imprévue, éditions La cause des livres, 2010